Les conférences d’Égards. Les impasses du conservatisme* (texte intégral)
Mise en ligne de La rédaction, le 19 septembre 2015.
Les conférences d’Égards. Les impasses du conservatisme* (texte intégral)
par Jean Renaud
[ EXTRAITS DU NUMÉRO 48 / AOÛT-OCTOBRE 2015 ]
La revue Égards, qui se prépare à compléter sa douzième année, ressemble probablement de moins en moins à ce qu’elle voulait être, et de plus en plus à ce qu’elle est. Au jour le jour, petit à petit, la revue a acquis son identité propre. Elle a établi sa figure au cours des ans, réalisant une partie de ses objectifs initiaux, en mettant de côté certains autres, y ajoutant des traits imprévus par les fondateurs, dessinant un portrait sans cesse retouché par les circonstances, les perceptions, et l’évolution morale, intellectuelle, doctrinale de ses rédacteurs et de ses artisans.
Mais deux petites phrases demeurent, répétées sur toutes les couvertures de la revue depuis le numéro 1, sans aucune exception jusqu’ici. À l’origine du nom même de la revue, elles appartiennent à un grand écrivain suisse, Charles-Ferdinand Ramuz. J’avoue y être pour quelque chose. J’aime «le ramuz», comme disait Aragon, qui est presque une langue en elle-même, proche de celle rêvée par le Platon du Cratyle. Si j’avais à reprendre le parallèle proposé par René Daumal entre ce qu’il nomme la poésie blanche et la poésie noire, je mettrais côte à côte les œuvres à la fois parentes et opposées de deux Ferdinand, Charles-Ferdinand Ramuz et Louis-Ferdinand Céline:
«La poésie noire est féconde en prestiges comme le rêve et comme l’opium, écrit Daumal. Le poète noir goûte tous les plaisirs, se pare de tous les ornements, exerce tous les pouvoirs, – en imagination. Le poète blanc préfère aux riches mensonges le réel, même pauvre. Son œuvre, c’est une lutte incessante contre l’orgueil, l’imagination et la paresse.»
Mais je reviens à ces deux petites phrases de Ramuz. Je me permets de les citer une nouvelle fois: «L’économique n’est pas tout. L’homme est aussi payé, il est surtout payé, par les égards.» La citation de Ramuz ne doit pas être perçue comme une sorte de bravade romantique, qu’on pourrait justement qualifier de poésie noire. Elle correspond à une position fondamentale terriblement négligée par le conservatisme actuel. Wilhelm Röpke, l’un des deux pères fondateurs de l’ordolibéralisme, s’est demandé, tout juste après la Seconde Guerre mondiale, quel était le contraire du totalitarisme. Est-ce que ce serait la liberté économique? Ce défenseur de la concurrence, cet ennemi de l’étatisme, ce partisan de la propriété privée se refusait à un tel simplisme. La liberté économique, aussi souhaitable soit-elle, ne peut à elle seule, rendre «au travail et à la vie de l’individu plus de dignité et de sens».
Le monisme économique libertarien – auquel n’est pas étranger le libéralisme classique – mène aussi sûrement au collectivisme que le socialisme puéril de Québec solidaire. Au-dessus de tous ces programmes exclusivement économiques, qu’ils soient de gauche ou de droite, il faut mettre un grand oeuvre politique, intellectuel, moral et spirituel sans lequel les libertés économiques sont vouées à périr, faute de sens et de racines.
Je touche du doigt, ici, l’une des impasses du «conservatisme». À une certaine démocratie de type républicain, idéologiquement activiste, incarnant un pouvoir politique qui est aussi (et surtout avec un Obama aux États-Unis ou un Hollande en France) un pouvoir spirituel, on n’oppose qu’un pur libéralisme économique, politiquement (et théologiquement) anomique, qui repose sur un utilitarisme sommaire et antimétaphysique. C’est à peu près ce qui reste du conservatisme, s’il en reste quelque chose.
Cette étroitesse conservatrice tient à un des traits de la culture moderne, qui est une culture «éclatée», comme on dit aujourd’hui, une sorte de mosaïque ou de collage, où s’entremêlent des spécialistes enfermés dans leur discipline et jugeant à partir d’elle de l’ensemble de la réalité, quand ils ne s’en remettent pas à un subjectivisme irrationnel. Le physicien croit tout savoir sur Dieu grâce à la physique et l’économiste sur la nature du bien grâce à l’économie. Aristote distingue la connaissance proprement scientifique d’un objet (une connaissance que l’on pourrait qualifier dans le vocabulaire actuel de spécialisée) de celle de l’homme cultivé proprement dit. C’est ce fruit de l’éducation libérale que le cardinal Newman appelait le gentleman qui est en voie de disparition.
On connaît la chanson de Brassens: «Quand un vicomte/ Rencontre un autre vicomte,/ Qu’est-ce qu’ils se racontent?/ Des histoires de vicomtes». Si l’expert est un Monsieur qui se trompe tout le temps, comme s’amusait à dire Jacques Bainville, ce n’est pas parce qu’il est plus bête que vous et moi, mais parce que son regard sur le monde a été déformé par la science particulière qu’il possède et qui le sépare paradoxalement du réel. Le spécialiste est pour ainsi dire celui qui ramène le tout à sa partie.
Un des caractères de l’homme cultivé par lequel il se rapproche davantage de l’homme du peuple que du spécialiste,
est son lien intact avec la totalité du réel, une façon de ne rien exclure de la réalité, d’attendre qu’elle lui parle, avant de lui imposer ses grilles d’analyse, lien auquel s’ajoute dans les meilleurs cas une certaine qualité d’attention qui constitue au fond ce qu’on nomme philosophie.
Évidemment, on ne peut se passer des spécialistes. La haute technicité des problèmes auxquels sont confrontées nos sociétés, la complexité de nos infrastructures, la place que tient la technologie dans nos vies les rendent indispensables. Le monde moderne a besoin d’eux, ce qui n’était pas vraiment le cas pour les civilisations agraires. Personne ne voudrait que l’avion dans lequel il voyage soit construit par un homme cultivé: on préfère de beaucoup de bons ingénieurs en aéronautique qui soient assistés par de bons ouvriers spécialisés. J’ai lu, récemment, un document sur le déclassement et le démantèlement de la centrale nucléaire Gentilly-2. C’est assez fascinant. Ça prend plus de cinquante ans pour en finir, avec un protocole très précis, et une technologie de pointe. Encore une fois, on ne met pas une centrale nucléaire entre les mains d’un homme cultivé.
Alors à quoi sert l’homme cultivé? L’élite technocratique contredit le peuple et aimerait en définitive l’abolir. Elle méprise son bon sens un peu court, son conservatisme instinctif, son enracinement, son étroitesse, et en somme sa fidélité aux vieux usages. Mais l’homme ordinaire, lui, peut-il résister aux prétentions du spécialiste? Comment s’opposerait-il à des chercheurs partisans de nouvelles méthodes pédagogiques capables non seulement d’augmenter le pourcentage de diplômés, mais aussi le pourcentage d’analphabètes? Entre l’homme ordinaire et le spécialiste, il faut ce traducteur de la culture commune qu’est l’homme cultivé, celui qui comprend le sens profond de ces traditions vécues par le peuple, conservées vaille que vaille dans ses mœurs et dans sa chair.
L’exemple de Jacques Parizeau
Je vais illustrer mon propos par l’exemple d’un Jacques Parizeau, qui est mort tout récemment, comme vous le savez.
Un jour, le haut fonctionnaire Jacques Parizeau présente au ministre du Travail d’alors, en l’absence du premier ministre Daniel Johnson père (nous sommes dans les années 1960), le budget de ce ministère. Le ministre s’appelait Maurice Bellemare, un vrai rural, comme l’Union nationale en comptait encore à cette époque. Parizeau lui propose d’augmenter les effectifs du ministère de vingt-sept à quarante-deux fonctionnaires. Maurice Bellemare demande de connaître leur description de tâches. «Ce sont des chercheurs, Monsieur le ministre», répond Parizeau. Le ministre Bellemare lui dit d’annuler ça: «Au Québec, on n’a pas besoin de chercheurs, c’est des “trouveurs” qu’il nous faut**.» Évidemment, l’anecdote est racontée par le biographe de Jacques Parizeau, Pierre Duchesne, pour ridiculiser Bellemare et bien illustrer que pour un ministre de l’Union nationale, comme disait en blague Parizeau lui-même, Tchaïkovski est le nom d’un joueur de hockey.
Qui oserait soutenir que Bellemare avait raison? Comment un homme «ordinaire» comme lui, qui fut mesureur de bois à la Consolidated Paper avant de devenir ministre, pourrait-il être dans le vrai face à un Jacques Parizeau?
Si Bellemare avait eu non seulement un instinct conservateur, mais un langage, un vocabulaire, une doctrine explicite, il aurait pu argumenter contre son haut fonctionnaire et expliquer à Parizeau que l’État québécois est en train de désagréger le capital social de la société civile en se substituant à ses institutions (je renvoie aux travaux de Gilles Paquet et de Gary Caldwell). Le technocrate détruit le lien social sans le remplacer. Un Parizeau a été un de ceux qui a établi la toute-puissance de l’État québécois, et de sa fonction publique technocratique, sur la société civile. Cela a été d’autant plus tragique que la fonction socialisante de l’Église catholique au Canada français, observée par Léon Gérin, n’a plus opéré avec la sécularisation accélérée. «La multiplication des seuls», dont parle Paul Valéry, a été exponentielle chez nous, plus radicale au Québec qu’ailleurs en Amérique.
Jacques Parizeau était fier d’appartenir à ce groupe d’une vingtaine de personnes qui a fait la Révolution tranquille. En une autre occasion, le nombre est monté jusqu’à presque quatre-vingts: une demi-douzaine d’hommes politiques, une douzaine de fonctionnaires, et une cinquantaine de chansonniers et de poètes (je vais revenir sur cette alliance de l’artiste et du technocrate non seulement dans le Québec moderne, mais dans l’ensemble de la culture occidentale).
Les plus âgés se souviennent que Daniel Johnson père a gagné les élections générales du 5 juin 1966 en dénonçant la mainmise d’une poignée de fonctionnaires et de technocrates sur l’État québécois. Jacques Parizeau, Claude Morin, d’autres moins connus, ont alors présenté leur démission, qui fut refusée par le premier ministre. Cet épisode, négligeable en apparence, établit nettement que l’antiétatisme de Daniel Johnson n’a pu dépasser le statut de thème électoral ou purement rhétorique: au fond, il ne voyait pas d’alternative à l’étatisme. Peut-être avait-il raison. L’étatisation qu’a subie le Québec dans les années 1960 s’est produite très rapidement – plus rapidement qu’ailleurs –, mais le processus ne diffère pas fondamentalement de ce qu’ont connu les autres sociétés occidentales. Le phénomène tient manifestement à l’essence de la civilisation actuelle et donc à une de ces impasses du conservatisme que j’essaie d’identifier.
On pourrait rétorquer que la tradition décentralisatrice de nos voisins du sud, admirée par le jeune Tocqueville, a été préservée et qu’elle donne davantage de possibilités aux «conservateurs» américains qu’à nous. Mais nous ne parlons en définitive que de différences régionales. La culture conservatrice yankee se dissout comme toutes les autres, se réduisant à quelques variations ressentimentales.
J’ai évoqué, à la suite de Parizeau, l’alliance des artistes et des technocrates. Rationalisme et subjectivisme sont les deux principaux aspects de l’idée moderne. Ce n’est pas contradictoire. Quand on ignore l’ordre naturel – «La nature est à droite», soutenait Ramuz – et qu’on lui substitue un monde artificiel, il reste les ingénieurs, qu’il s’agisse des ingénieurs en génie civil ou des ingénieurs sociaux ou même médicaux, et derrière eux, une petite voix, ou des milliards de petites voix qui disent: je désire, je veux, j’exige, encouragées par un art déchu que je qualifie de romantique ou, après Daumal, de poésie noire. Ici et là, les mœurs et les institutions profondément dénaturées sont remplacées par les diktats divers d’une subjectivité affolée, toujours au nom de l’émancipation personnelle. C’est le point commun, la prémisse, la pierre d’angle de la modernité – socialiste ou libérale – le moi, le moi seul!
En effet, l’illusion d’autonomie définit la modernité, non une autonomie relative, ordonnée à une transcendance qui, loin de la limiter, lui donne son extension maximale, mais une autonomie qui se veut absolue, créatrice de ses propres valeurs au nom de l’épanouissement personnel, un épanouissement aussi obsédant que débilitant.
Alors qu’une telle prémisse subjectiviste a longtemps été purement intellectuelle, partagée par une petite élite et une certaine frange de la bourgeoisie, elle est maintenant embrassée par presque tous. Et les effets pervers ne manquent pas. Les derniers seuils, les ultimes tabous, sont purement utilitaristes – ainsi du meurtre ou du vol. Mais qu’en sera-t-il de l’inceste, lorsqu’un théologien, un psychologue ou un sociologue nous expliquera qu’il n’a rien de condamnable lorsqu’il se consomme entre deux adultes consentants? De là une certaine exaspération des peuples qui, paradoxalement, nourrit et accélère un libéralisme anomique impatient d’abolir toutes les frontières, nationales, sexuelles, culturelles, morales, et toutes les résistances, au nom d’une liberté-principe se dévorant fatalement elle-même (rien de plus angoissant que l’absence de limites).
Voilà le grand paradoxe: l’autonomie absolue entraîne une absolue dépendance. Les caractères s’effondrent en même temps qu’ils se libèrent. «Ils ont réussi parce qu’ils se sont choisis», dit une publicité pour un régime amaigrissant. Mais se choisir soi-même, c’est se perdre.
Le subjectivisme clérical
Est-ce que face à cette technocratie, le peuple garde un recours quelconque grâce à son élite cléricale au sens large? On peut en douter. Je lis dans l’éditorial du Prions en Église du 12 avril 2015 qu’»il est possible de vivre une vie pleine et heureuse sans Dieu». L’affirmation est assez singulière. Mais on est moins étonné quand on sait que celui qui l’a écrite, Jacques Gauthier, est docteur en théologie, diplômé de l’Université Laval. On est très loin du tragique nietzschéen: «Dieu est mort, et c’est vous et moi, qui l’avons tué». Non! Que Dieu soit mort ou vivant, ça ne change rien.
Le 7 juin dernier, le rédacteur en chef du même Prions en Église, Jean Grou, a prodigué aux fidèles son enseignement sur la famille. Je le cite: «Certains disent qu’elle est en crise. Je dirais qu’elle évolue.» Remarquez ici la langue de bois du libéralisme clérical, plein d’optimisme et d’aveuglement. Écrire que la famille évolue est moins éclairant encore que d’expliquer que l’opium fait dormir à cause de sa vertu dormitive. Parler de crise paraîtrait trop négatif à ces gens-là, presque méchant, dirais-je. Leur Dieu ressemble, pour paraphraser Kierkegaard, à «quelque chose de doux, de mou, qui n’est ni Dieu ni homme». Ce n’est même plus le Dieu horloger de Voltaire, qui était sans cœur mais qui n’avait pas perdu la raison, c’est un Dieu chic type, qu’on peut mettre à la porte quand il nous dérange et réinviter plus tard. Jean Grou continue dans ce même texte à louer la culture actuelle: «Le portrait “éclaté” des familles d’aujourd’hui est peut-être bien le reflet d’un monde ouvert où les expériences de vie s’entrecroisent et s’enrichissent mutuellement». On voit ici à quel point cette culture cléricale est non seulement tributaire de la culture de l’émancipation personnelle, mais en est une version presque caricaturale.
On peut s’opposer à un Parizeau, mais jamais il ne pourrait être aussi bête qu’un docteur en théologie ou qu’un rédacteur du Prions en Église. Rien de plus plat qu’une pastorale délestée de tout lien avec la vérité, une vérité qui devrait la nourrir et la définir.
La difficulté qu’a eue Maurice Bellemare à résister à Jacques Parizeau se reproduit chez le fidèle ordinaire devant Jacques Gauthier ou Georges Leroux. Prenez un catholique pratiquant, dont la foi est simple, plus intuitive que savante, plus implicite qu’argumentée. Ce qui tient lieu de missel à ce représentant courageux du dernier carré de croyants québécois contredit ses instincts profonds, et le fade libéralisme néo-sadducéen qu’il y trouve, s’il ne l’indigne pas, a nécessairement sur lui une vertu dormitive. En le supposant timide, ou peu sûr de lui, il ira jusqu’à se sentir humilié de ne pas être à l’unisson avec ces docteurs de la confusion et du sentimentalisme. Et nos modernes sadducéens, eux? Ils ne ratent jamais une occasion de rabaisser la foi du croyant ordinaire puisqu’elle n’est pas «le reflet d’un monde ouvert», mais d’une société arriérée.
L’homme ordinaire ne peut se défendre contre la culture dominante, aussi peu compatible soit-elle avec ses instincts profonds. Qu’il s’agisse d’un économiste ou d’un théologien technocrates, ils sont trop forts pour lui. On pourrait évoquer un processus de prolétarisation idéologique. Ce qui reste du peuple est considéré comme une anomalie. Et les sombres lumières que diffusent l’université et les médias sont censées effacer ces reliquats d’un autre temps.
Un jeune sociologue, Frédéric Parent, très influencé par Léon Gérin (il prépare actuellement une édition de sa correspondance familiale), vient de publier, dans la lignée du maître, mais aussi d’une Colette Moreux, une enquête ethnographique menée dans un village de la grande région de Québec, intitulée Un Québec invisible (PUL, 2015). Qu’est-ce que le Québec invisible? C’est celui «qui mène une lutte obscure et maladroite contre la dépersonnalisation», soutenaient Madeleine Ferron et Robert Cliche, tous les deux de gauche, à l’occasion d’une analyse du vote créditiste. Plus récemment, le politologue Pierre Drouilly a noté que l’aire d’influence de la défunte ADQ correspondait à peu près à celle du Crédit social – il y a là une continuité révélatrice.
Mais que peut le peuple? Je vais proposer une analogie théologique, parce qu’elle éclaire une structure qu’on retrouve autant dans l’Église que dans la vie de la Cité: «Il ne faut pas oublier une chose, écrivait Ratzinger: de par toute son essence et sa fonction, la foi de la communauté n’est pas un facteur productif mais conservateur. Lorsqu’elle devient productive, il faut s’en approcher avec prudence parce qu’elle suit les lois de l’imaginaire populaire comme l’Histoire l’a démontré très clairement. Elle acquiert le caractère d’instance là où elle sauvegarde le bien qui est commun et non pas quand elle en produit.» On discerne ici une hiérarchie vivante qui s’applique de nouveau aux affaires temporelles. On pourrait comparer le bon sens populaire au démon de Socrate. Il dit non à bon escient, mais sans pouvoir devenir législateur…. Il refuse l’étatisme, mais sans être capable de lui opposer une doctrine économique solide. Cette tâche incombe ou devrait incomber à l’élite, à une élite composée d’hommes cultivés au sens d’Aristote ou de Pascal, et non de technocrates.
Je ne dis pas qu’une telle élite – présentement décimée, si elle existe encore – est plus importante que le peuple. Je crois le contraire, parce que l’élite vient du peuple et non l’inverse. Une élite, ça se remplace («L’histoire est un cimetière d’aristocraties», répétait Pareto); un peuple, ça ne se remplace pas. Je me permets de reprendre l’analogie théologique, toujours avec Ratzinger qui soulignait que le passage de l’ancien au nouveau testament a été rendu possible grâce à l’intercession de cette foi des «simples», des anawim (les «pauvres»), aussi étrangers au littéralisme pharisien qu’au libéralisme sadducéen. Ils «vivaient du noyau central de la promesse et de la Loi», note Ratzinger, évoquant les noms de Zacharie, d’Élisabeth, de Joseph et de Marie. Le Christ est né dans ce milieu-là: il n’appartenait pas à une famille de technocrates ou de théologiens libéraux. Cette richesse intérieure est l’humus par lequel tout est rendu possible et sans lequel le désert croît. Mais cela ne suffit pas à tout. Une élite doit traduire cette réalité cachée. Est-il possible de contribuer à l’émergence d’une élite qui se mette au service de ce peuple encore attaché par sa vie et ses actes à ce qui constitue le noyau fécond de toute existence vraiment humaine: fidélité, piété, constance, amour? Égards est au fond une revue invisible qui s’est lancée à la défense d’un Québec invisible, ce Québec invisible qui au demeurant ne lit pas. Notre directeur pourrait s’appeler «Griffin», l’anti-héros de Wells – nous avons d’ailleurs déjà envisagé, moi et Patrick Dionne, une telle nomination. Notre effort principal a consisté à définir les principes politiques, esthétiques, moraux et métaphysiques qui devraient guider l’action d’une élite dont l’objectif ne serait plus de contredire ou de mépriser – pour citer les mots du maître de Léon Gérin, Frédéric Le Play – «la constitution essentielle de l’humanité», mais de la soutenir, de l’adapter, de la pénétrer de raison, de la protéger contre les sophistes et les calculateurs…
Ce travail, nous ne le faisons pas sans hésitation, ni faux pas, ni embarras, ni doutes, ni détours, ni illusions, ni recul, ni lassitude, ni tâtonnements quelquefois (il n’y a pas de directives écrites d’avance pour les restaurations morales et intellectuelles), mais avec une certaine opiniâtreté peut-être, nécessaire avec les «causes perdues» («lost causes») comme disait le Mr. Smith de Frank Capra.
Je n’ignore pas l’intensité de la crise actuelle. Elle s’enracine dans la psyché de chacun. Qui parmi nous oserait se flatter de ne pas être blessé ou diminué par nos effondrements sociaux et moraux? La sagesse politique ne peut guère que retarder l’évolution d’un mal qui ronge l’Occident entier, et le reste du monde avec lui. Le pouvoir de guérison d’une sagesse toute terrestre ne va jamais jusqu’au cœur. Et puis les cités, les peuples, les civilisations sont mortels. C’est pourquoi «il faut porter plus haut ses espérances», enseignait Bossuet. Il y a une instabilité et une fragilité constitutives aux choses humaines qui n’empêchent pas la confiance. La sagesse politique n’a pas pour fonction de sauver le monde, mais de le préserver autant et aussi longtemps que possible.
* Le 18 juin 2015, à la Bibliothèque Albert-le-Grand à Montréal, furent célébrées un peu en avance les douze premières années de vie de la revue Égards. En cette occasion, Patrick Dionne a présenté l’orateur principal, Jean Renaud, tandis que ce dernier a traité le thème des «impasses du conservatisme».
** Pierre Duchesne, Jacques Parizeau, tome 1: Le Croisé, Montréal, Québec Amérique, 2001, p. 399. L’anecdote, reprise par Pierre Duchesne, a été d’abord racontée par Jean Loiselle, qui fut témoin de la discussion en tant que chef de cabinet de Daniel Johnson.
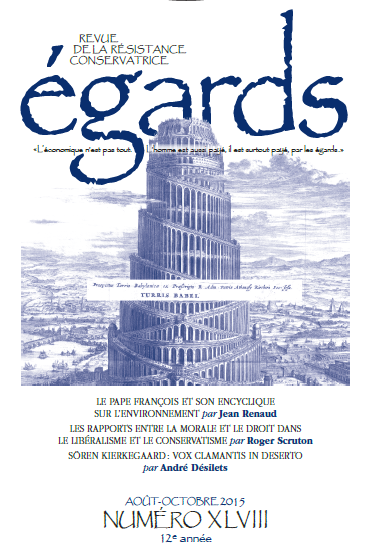
Écrire un commentaire
You must be logged in to post a comment.