DOCUMENT – Esthétique et politique (texte intégral)
Mise en ligne de La rédaction, le 27 mars 2023.
PAR JEAN RENAUD
[Le titre, les sous-titres et les notes, ainsi, bien entendu, que l’avertissement ont été ajoutés en novembre 2022.]
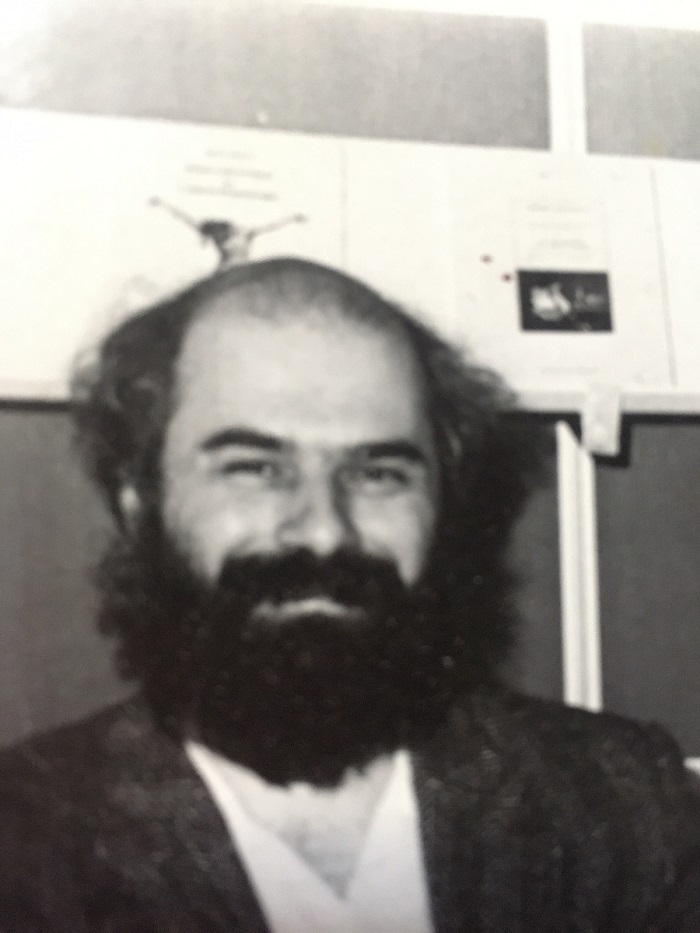
Avertissement (presque 40 ans plus tard)
Sauf en cas de guerre, de famine ou de catastrophe naturelle, je ne conseillerais à personne de déménager, surtout après quelque quarante ans dans le même appartement. J’ai d’ailleurs toujours cru, avec le poète, que le prurit de changement était suspect :
L’homme ivre d’une ombre qui passe
Porte toujours le châtiment
D’avoir voulu changer de place.
Mais à toute chose malheur est bon. Un effet collatéral d’un tel remue-ménage est l’espèce d’inventaire auquel il nous contraint : on découvre des objets, des souvenirs, des lettres, des ébauches qu’on avait oubliés (le plus souvent à bon escient) ou qu’on croyait perdus. Entre mes 25 ans et mes 65 ans, il en est passé de l’eau sous les ponts et… beaucoup de papier sous la plume, surtout pour une victime (consentante) depuis plus de cinquante ans de la méchante manie d’en noircir.
Le texte que l’on lira ci-dessous a été retrouvé « classé » (le mot est fort) dans une chemise sur laquelle était écrit « Discours à Paris ». Aucune date, ni description de l’événement. Incidemment, il était tapé à la machine à écrire (non électrique). Après lecture, j’ai deviné qu’il s’agissait du lancement parisien de mon premier livre La Quête antimoderne publié en 1985. Le fait qu’il eut lieu au Centre culturel canadien m’a fait sourire. Peut-on imaginer endroit plus conformiste que cette institution fondée en 1970, sous l’égide du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ? Comment un ouvrage aussi sulfureux a-t-il pu profiter de ce haut lieu de la « culture canadienne » à Paris ? Bizarrement, grâce à Yoland Guérard, qui en fut le directeur les deux dernières années de sa vie (nommé en 1985, il mourut en banlieue parisienne en 1987). Les plus jeunes ont peut-être oublié ce personnage alors bien connu : chanteur, animateur d’émissions populaires à la télévision, comédien (il joua notamment le rôle du père de Maria Chapdelaine dans le film éponyme de Gilles Carle), il fut aussi, paraît-il, haut gradé rosicrucien (notre collaboratrice Marie-France James en sait certainement plus que moi à ce sujet). Je ne fréquente nullement le « grand monde », comme disait ma mère, pas plus en ce temps-là qu’aujourd’hui, mais Roland Houde, professeur de philosophie colérique, attachant, extrêmement érudit et brouillon, était un de ses bons amis et put préparer le coup. Par l’entremise de Roland Houde et de Yoland Guérard, une espèce de « happening » antimoderne et royaliste put être organisé autour d’un premier livre. Le mot « happening » ne vient pas de moi (qui aurait préféré un lancement plus modeste), mais du maitre d’œuvre parisien de l’événement, Joël Bouessée, un spécialiste des chasses à courre et de Gabriel Marcel. L’autre conférencier était le guénonien et royaliste Henry Montaigu, le directeur de La Place royale, une revue, on l’aura deviné, monarchiste. Je me souviens aussi que Jean-Marie Domenach, l’ancien directeur de la revue Esprit, proche d’Emmanuel Mounier et d’Albert Béguin, était présent dans la salle. Mon intervention, on le verra, n’avait rien qui pouvait nourrir un quelconque « happening ». Elle poursuivait la tonalité plutôt intime de La Quête antimoderne. J’avais d’abord reconnu en moi les racines du mal moderne, un mal dont j’étais donc la proie et le chasseur, le responsable et le dénonciateur.
Il est peu question de politique dans ce petit texte, quoiqu’elle apparaisse tout le long en filigrane. L’esthétique y est davantage à l’honneur. J’étais encore marqué par le rationalisme subjectiviste et le nihilisme raffiné d’un Paul Valéry, dont je me libérais lentement. Et je m’approchais graduellement de ce qu’Albert Thibaudet a appelé une « esthétique des trois traditions ». Je fréquentais alors non seulement Charles Maurras, le puissant doctrinaire de la monarchie, mais aussi T.S. Eliot : « Classicist in literature, royalist in politics, and anglo-catholic in religion. » Car l’esthétique n’est pas étrangère à la chose publique : « Il y a clairement une analogie entre une profusion d’images sans structure et la notion de démocratie pure », écrivait Santayana. À l’opposé du romantisme et de ses avatars, l’esthétique classique bannit tout égalitarisme : elle défend, pour le bien de l’œuvre, les notions de composition, d’ordre et de hiérarchie, mais aussi celle de nature, avec ses détours, sa diversité, sa richesse, à rebours de l’esprit géométrique et d’un subjectivisme générateur d’angoisse, d’idées fixes et d’ennui.
Ce petit texte témoigne surtout d’un appel à la hiérarchisation de nos puissances intérieures. Chaque homme de chair, humble microcosme, qui y répond, reproduit en lui le caractère hiérarchique du macrocosme, de l’univers qui nous entoure, visible et invisible. Cette nécessité d’une hiérarchie morale étant admise pour l’individu (et plus ou moins incarnée) – et ce à l’imitation d’un ordre naturel qui, même obscurci, l’enseigne clairement –; il restait à l’établir dans ce médiocosme (j’emprunte le néologisme à Vladimir Volkoff) qu’est la cité, la communauté politique.
Il faut reconnaître que la notion de hiérarchie est plus riche que celle d’inégalité. Le concept d’inégalité est purement négatif et ne comporte pas en lui-même l’idée d’ordre ou de justice. En pratique, « inégalitarisme » et égalitarisme ne s’opposent qu’en apparence : l’inégalité intégrale ressemblerait en somme à une démocratie pure – une égalité dans l’esclavage sous le joug d’un despote; quant à l’égalité intégrale, elle est impossible; ce qui existe, c’est l’obsession de l’égalité : il n’y a d’égalité que létale. Aristote ou Thomas, au contraire de Berdiaeff, n’auraient jamais parlé de philosophie de l’inégalité. Pour eux, dans le contexte des choses humaines, l’égalité doit être proportionnelle pour être quelque peu juste. Dans la réalité humaine vivante, on se trouve, soit devant une inégalité apparente qui relève d’une égalité plus ou moins approximative de proportion (dans les cités des hommes, il faut tenir compte des marges d’erreur considérables dues à l’orgueil, à la vanité, à l’avidité, à la sottise, à l’envie), soit devant une inégalité clairement disproportionnée (et ce cas trop fréquent explique pourquoi l’histoire est un cimetière d’aristocraties). Le mot hiérarchie, lui, est positif : il contient en puissance les concepts d’ordre, de subordination, de réciprocité des services (des services nécessairement différents les uns des autres et donc inégaux). Il annonce implicitement ces bienfaits sans contredire la notion aristotélicienne et thomiste de proportion. Bref, il n’y a pas d’inégalité équitable sans tenir compte (même imparfaitement) d’une certaine égalité. Dans la philosophia perennis, l’égalité s’adapte au réel; dans la modernité rationaliste, c’est le réel qui doit se plier à l’égalité, chose on l’a vu impossible.
Ces clarifications et ces approfondissements sont venus plus tard. En leur temps. Toutefois, même à l’état inchoatif, une certaine préférence pour la monarchie découlait déjà, presque naturellement, de ces méditations et de ces ébauches. Voici donc ce petit discours qui témoigne au moins d’un départ dans la vie de l’esprit…
I. Errance
Comment parler de soi ? « Dire je, c’est mentir », disait Simone Weil. Ne pas dire je, n’est-ce pas mentir plus encore ? C’est notre condamnation de ne vraiment pouvoir nous résumer que par de mornes et honteuses confessions. Mais que révéleraient-elles, sinon nous, nous seuls, et qui n’est que lui-même ? Nous n’existons vraiment que par ces appels devinés ou entendus qui, littéralement, nous portent et nous soutiennent, sans pourtant nous appartenir. Parler de soi comme si l’on se possédait, comme si l’on pouvait se dominer et se juger, il n’est peut-être pas de plus grande naïveté. Le je qui domine et qui trône, voilà certainement la part la plus insignifiante de nous-même; l’expression américaine « self made man » est une sottise et une impiété : en tout le meilleur nous est donné. Le volontarisme moral, politique, économique a appauvri et enlaidi nos mœurs. Ce mépris de l’inhumain, qui est quelquefois le divin, de l’inattendu, qui peut être ce que l’on espérait plus que tout, du gratuit, qui est souvent le précieux, du donné, qui est parfois l’inaccessible, nous cantonne à ce moi haïssable, infatigable pourvoyeur de je veux sans grâce et toujours inassouvis. Ce volontarisme coexiste d’ailleurs avec nos plaintes efféminées devant la tyrannie des choses, comme si l’homme n’avait pas le haut pouvoir d’acquiescer à l’univers, pouvoir qu’il doit davantage à un intime et stoïque silence qu’à ses actes. Nous ne nous possédons pas, nous nous poursuivons plutôt. Par l’intercession des êtres et des choses, nous cherchons à atteindre un moi rêvé qui serait à la fois moi et plus que moi. Comme plusieurs, j’ai longtemps erré dans ces apparences aux regards profonds ou vides que figurent la poésie, la philosophie et cette métapolitique dont la manie m’était venue par la fréquentation de ces grands Russes visionnaires qui ont ébloui l’enfance et l’adolescence de mon esprit. « Métaphysique » ! Comme ce mot m’a fasciné, enrichi qu’il est du meilleur et du pire de l’homme ! Je ne puis d’ailleurs, pas plus aujourd’hui qu’hier, en définir la nature véritable, n’ayant pas dépassé en ce domaine une réflexion fort vague sur la métaphysique des autres. Je n’ai pourtant jamais nié la possibilité d’une vérité supérieure, mais mon esprit n’a jamais su choisir si haut. Choisir ? D’en bas, il s’agit bien de choisir et d’élire, au risque de se tromper, au risque même d’avoir raison.
J’ai longtemps erré, disais-je. L’errance, l’éclaté, le multiple, le dispersé, voilà des mots à la mode. Certains modernes exhibent leur confusion comme une découverte, un honneur et même parfois un bonheur. Il y a souvent de la sottise et quelquefois de l’hypocrisie dans ces apologies purement verbales (aussi habiles soient-elles) de l’informe et du désordre. N’appelons pas règle et bonheur ce qui appelle sa règle et son bonheur. En se gardant de vouloir mettre toute cette matière psychique qui nous habite sous le joug chimérique d’un je qui est possédé bien plus que possédant, il serait sacrilège de laisser s’entre-dévorer ces miettes de nous-mêmes sans tenter de les soumettre et de les réconcilier.
II. Un ordre classique ?
Qu’est-ce qu’un classique ? J’ai déjà proposé une définition très générale et peut-être féconde : « J’appelle classique celui qui a réalisé, par sa vie ou par son œuvre, l’accord hiérarchisé de ses puissances. Cela n’est possible que par des règles ascétiques et, d’ailleurs, dans leurs modalités techniques, arbitraires. Je n’appelle pas classique celui qui écrit de bons livres, ou même de grands livres, mais celui qui s’est rendu “maître du point d’où [semblent] sortir tous les livres” (Maurice Blanchot), c’est-à-dire maître de lui-même. » On parle d’époques classiques. L’idée, familière à un Voltaire, de quelques moments heureux dans l’histoire, et brefs, où, par grâce et par maturité, l’homme réussit à créer des œuvres, voire des institutions, dignes de ses rêves et de ses meilleures pensées, cette idée, dis-je, est source de beaux regrets et de beaux espoirs. Par malheur, la réémergence d’une telle époque dépend si peu de nous, nous en sommes si éloignés, que le recours historique et, si j’ose dire, anecdotique n’est guère utile. Ce recours est surtout personnel, au mieux élitiste – osons le mot qui effraiera les oreilles trop facilement intimidées par un rêve de fraternité servile, par le bas, qui nous éclabousse tous plus ou moins, Et pourtant, même dans le cadre modeste de nos vies individuelles, comme cette quête paraît inaccessible, étrangère à nos sensibilités, aux routes et déroutes de notre pensée et de nos songes. Ce qui nous caractérise le mieux, c’est une dissociation intérieure, une profonde inaptitude à devenir un. Une sensibilité divisée que tout excite et que rien ne nourrit, une raison réfugiée à la surface de nous-mêmes, pour paraphraser Barrès, se disputent notre âme, par ailleurs parfaitement soumise à la tyrannie d’images, de sons et de moignons d’idées de plus en plus grossiers, adaptés à la régression générale. C’est ce que les ésotéristes, ces grands dadais, ont nommé l’ère du Verseau; je l’appellerais plutôt l’ère du cri primal : que reste-t-il d’authentique en nous qu’un misérable gémissement qu’en d’autres temps l’on aimait mieux voiler, mais qui est devenu une bouée de sauvetage, à nous qui ne nous sommes pas remis d’être nés.
III. L’avènement du nihilisme
Tous nos efforts d’unité intérieure ne peuvent qu’être vains, semble-t-il, trop d’êtres divers et ennemis pullulent en nous. Si nous perdions la parole et marchions à quatre pattes, nous serions sauvés. C’est au fond la principale leçon de la psychologie moderne. Leçon que je ne dédaigne pas. Il est inconfortable d’être homme. L’antique effort d’être un peu plus qu’une vomissure doit peut-être être laissé aux générations futures, plus naïves, peu enclines par impéritie au désenchantement et suffisamment abruties pour être dégoûtées du charme précaire des bas-fonds. Il est trop évident que depuis quelques décennies l’intelligentsia occidentale s’est progressivement lassée d’avoir une tête et un cœur : il y a au fond de l’antihumanisme contemporain une fascination pour le néant, une volonté d’être pour anéantir, pour citer Louis Lavelle, en vue d’interrompre le désespérant projet d’être homme.
IV. L’ennoblissement est-il possible ?
« L’ennoblissement est-il possible ? » Cette question du jeune Nietzsche, j’ai voulu la faire mienne. Quelle question plus antimoderne que celle-là ? Pour un projet aussi fantasque sont exigées une métaphysique et une morale, tandis que les maîtres à penser de l’époque sont des psychologues, des nihilistes ou de populaires scouts bondieusards et sermonneurs. La critique du monde moderne commence par celle de ses multiples conceptions de l’homme qui, bassement optimistes ou cruellement désespérantes, ont le point commun d’ignorer « comment l’homme s’éternise ». Notre époque écervelée a imaginé un nouvel homme parfaitement libéré de tout soutien transcendant, de tout recours supérieur. Ce pauvre hère s’est rapidement débauché, mal servi par son dénuement et par sa myopie. Le thème récurrent de « l’éminente dignité de l’homme », aussi utile et bienfaisant soit-il pour un prêche ou un discours politique, méconnaît à quel point n’est éminemment digne que ce qui est impersonnel, ces vérités au-delà de notre chair et de nos passions seules propres à nous former et à nous soutenir.
V. Savoir réagir
Comment réagir face à l’irruption de cet homme sans mémoire, et donc sans cœur ? Je distingue au moins deux voies, naturellement inégales entre elles. D’abord, l’édification « d’une Chevalerie nouvelle, comme le suggère Maurras, au service du Beau et du Bien ». Chevalerie au singulier est trop ambitieux ou trop exclusif : l’essentiel étant d’assurer autant que possible, minimalement chez quelques-uns, la primauté du spirituel, du je-ne-sais-quoi ou du presque-rien, du germe, de ce qui ne se voit pas, et ce malgré l’avènement de la technique, contre l’époque, dans une belle, gratuite et libre affirmation de l’inutile. L’autre voie, plus nécessaire encore, consiste à servir ce dernier refuge de ce qui reste d’âme, de vérité et de liberté dans le monde qu’est la sainte Église catholique, apostolique et romaine, représentée par sa hiérarchie et incarnée dans ses saints (toujours vivants, toujours actifs). Je reconnais que l’Église est devenue un lieu ambigu, qu’elle est pénétrée elle aussi de la maladie égalitaire et utilitaire; mais ses concessions restent limitées par ce qu’elle est et si, comme la foi catholique l’enseigne, elle est appelée à durer jusqu’à la fin des temps, son action et ses effets sur les mœurs et la culture sauront possiblement préserver l’esprit à l’origine de ces biens d’un interminable assoupissement.
VI. De quoi demain sera-t-il fait ?
Heureusement, l’avenir nous est scellé. Ni le pire ni le meilleur ne sont certains. Plus radicalement encore, l’avenir n’appartient pas à l’ingéniosité humaine ni même à son génie, toujours intermittent. Non que l’homme ne joue aucun rôle, non que ses efforts ou ses rêves ne puissent être fructueux; mais ses réussites supposent une bienveillance du sort – ou du moins sa neutralité – sans laquelle il ne peut rien. L’avenir n’est guère plus dans le cœur de l’homme qu’une inquiétude; ce qu’il sait de demain se confond à peu près avec ce qu’il ignore. Demain n’est d’abord qu’une prière.
À l’homme, au-delà de toute infortune, est toujours offert le don précieux d’un abri œcuménique. Mais celui-ci ne nous autorise pas à oublier que le terrestre et le charnel importent, qu’ils sont le vase d’élection de notre action et de nos vœux, la matière de notre destin et de nos entreprises, que ses racines ne se limitent pas à la terre. Le poète l’a dit :
Car le surnaturel est lui-même charnel
Et l’arbre de la grâce est raciné profond.
Cette part de l’avenir qui dépend de nos volontés peut bien être infime, c’est notre part. Sans oublier toutefois qu’on ne doit jamais agir comme si Dieu n’existait pas, qu’on ne réussit rien à rebours des volontés supra-humaines. « Qu’est-ce que Dieu veut pour ce monde ? » est peut-être une question à laquelle il est chimérique de vouloir répondre avec assurance, mais il est sage d’en être tourmenté. Notre espérance au sens fort doit savoir par moments contredire nos inclinations et nos souhaits si elle veut correspondre pleinement au mystérieux appel de la création pour trouver ou retrouver sa loi et son bonheur. Toute entreprise est d’abord le fruit d’un pacte avec une Volonté supérieure à l’humaine impuissance.